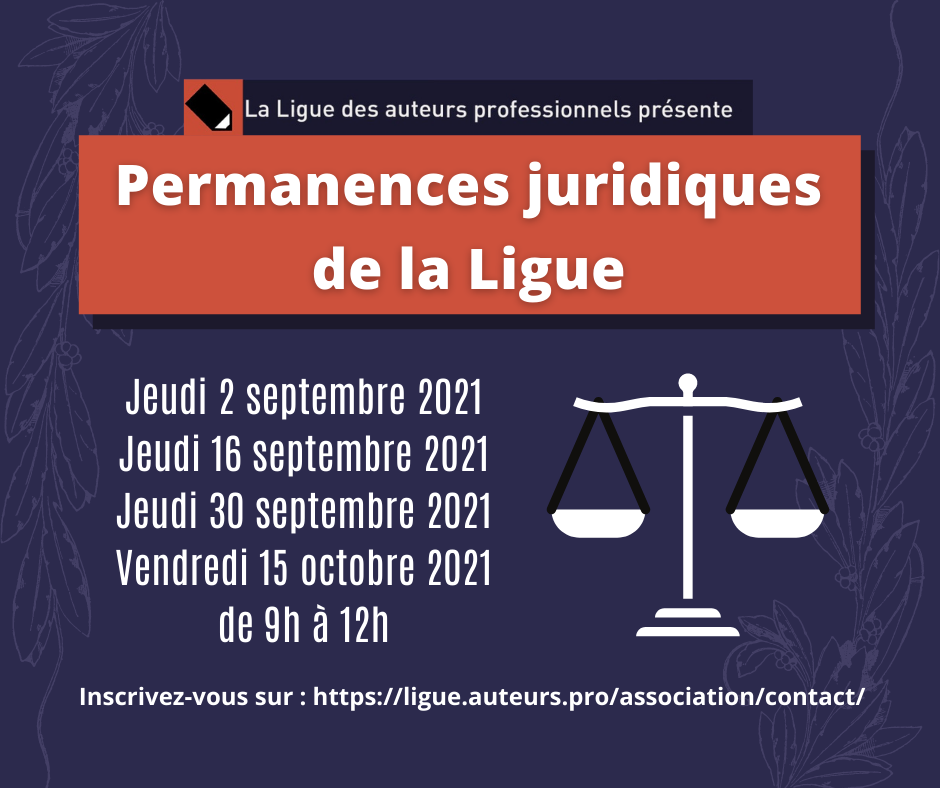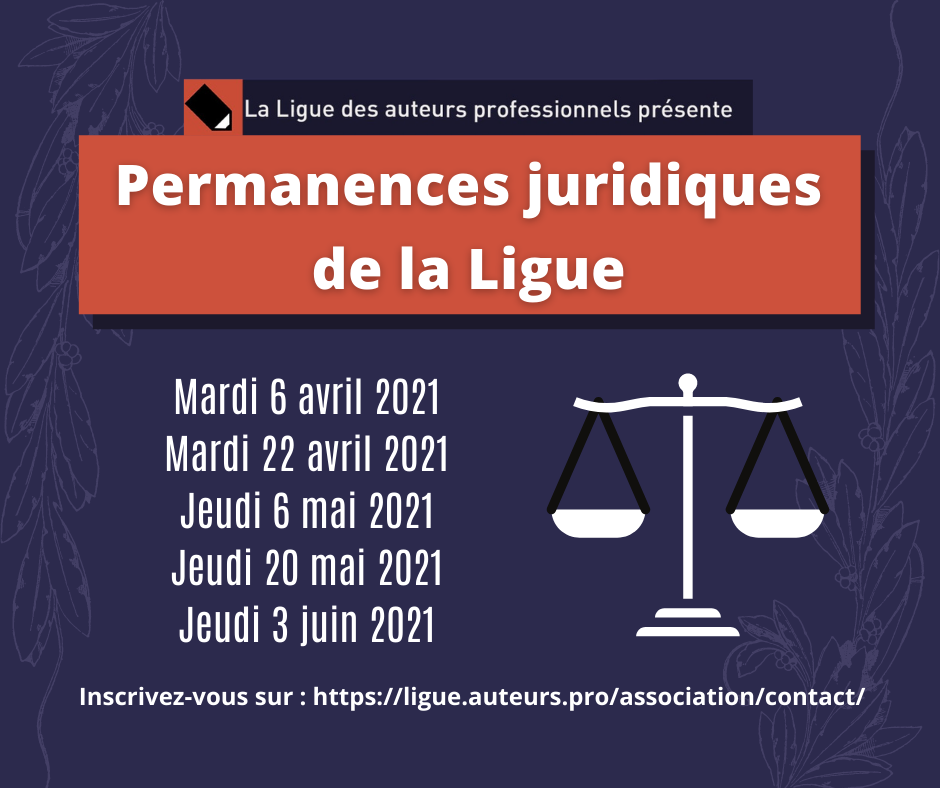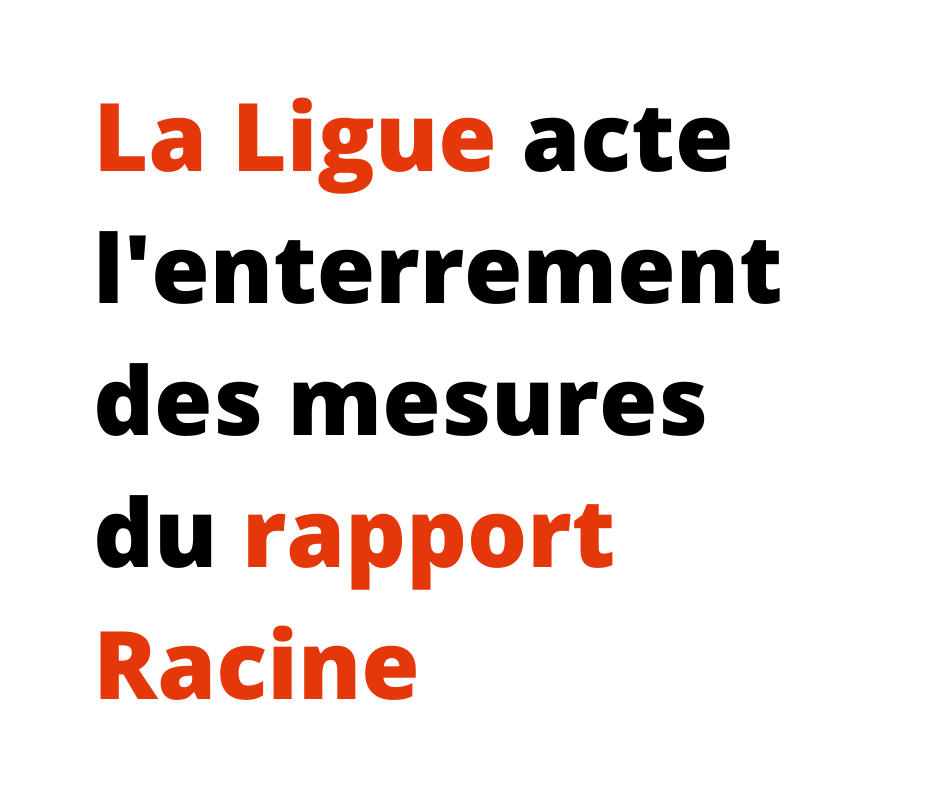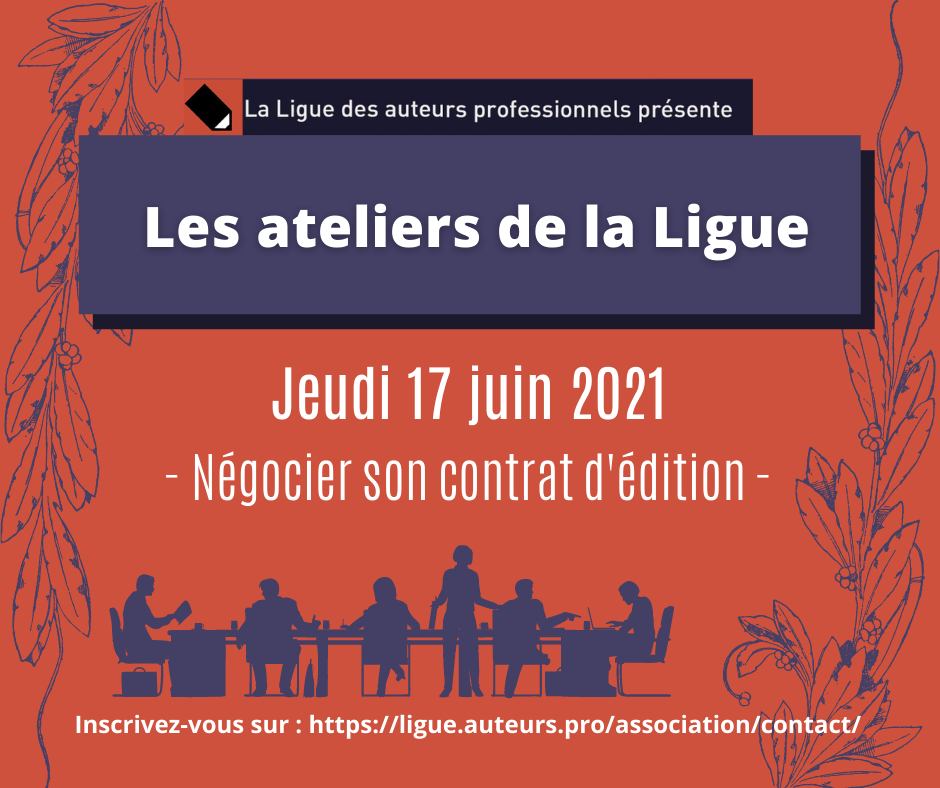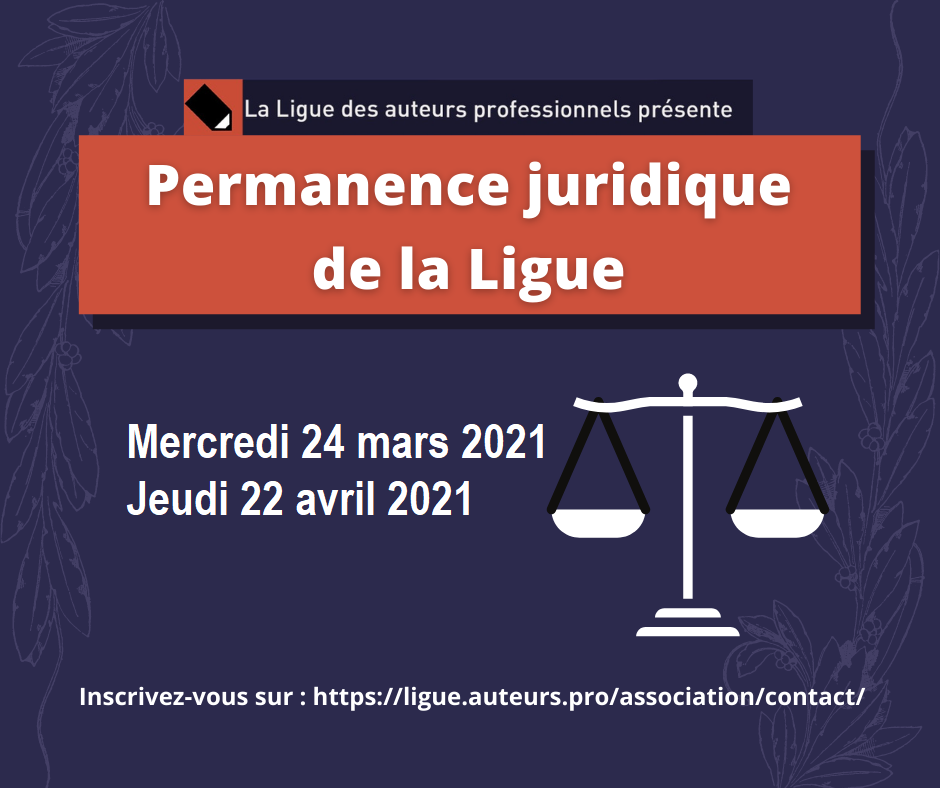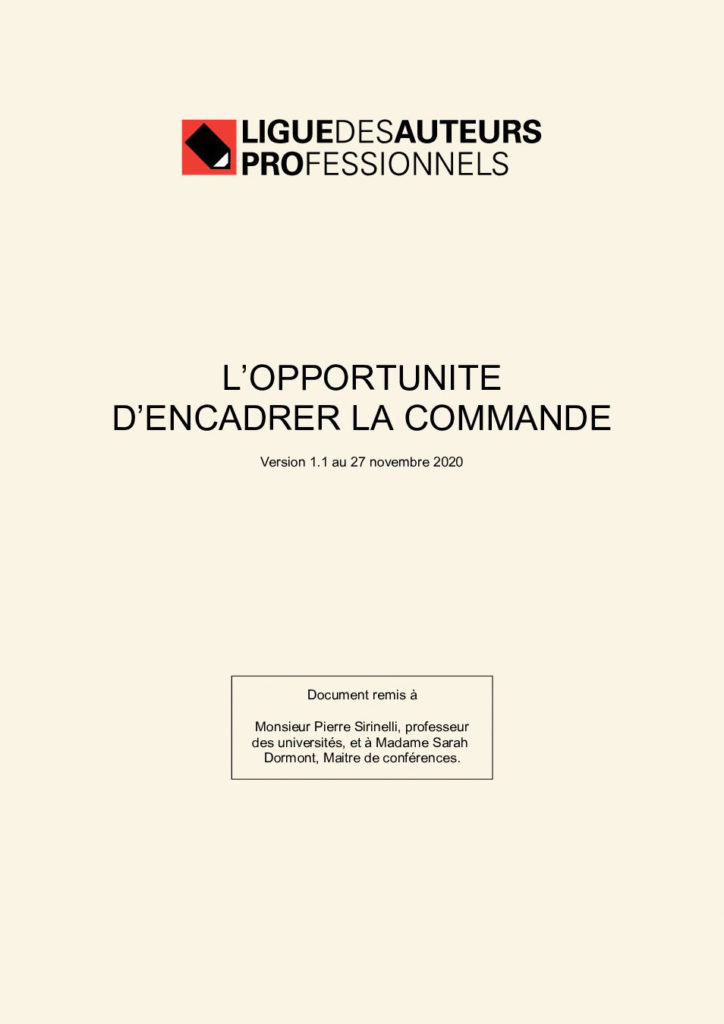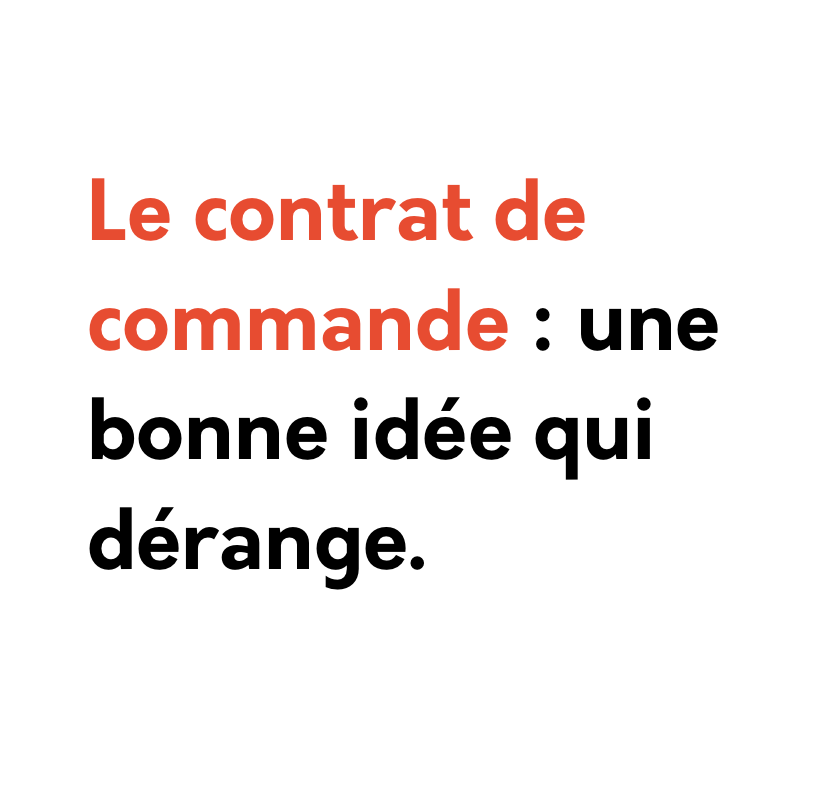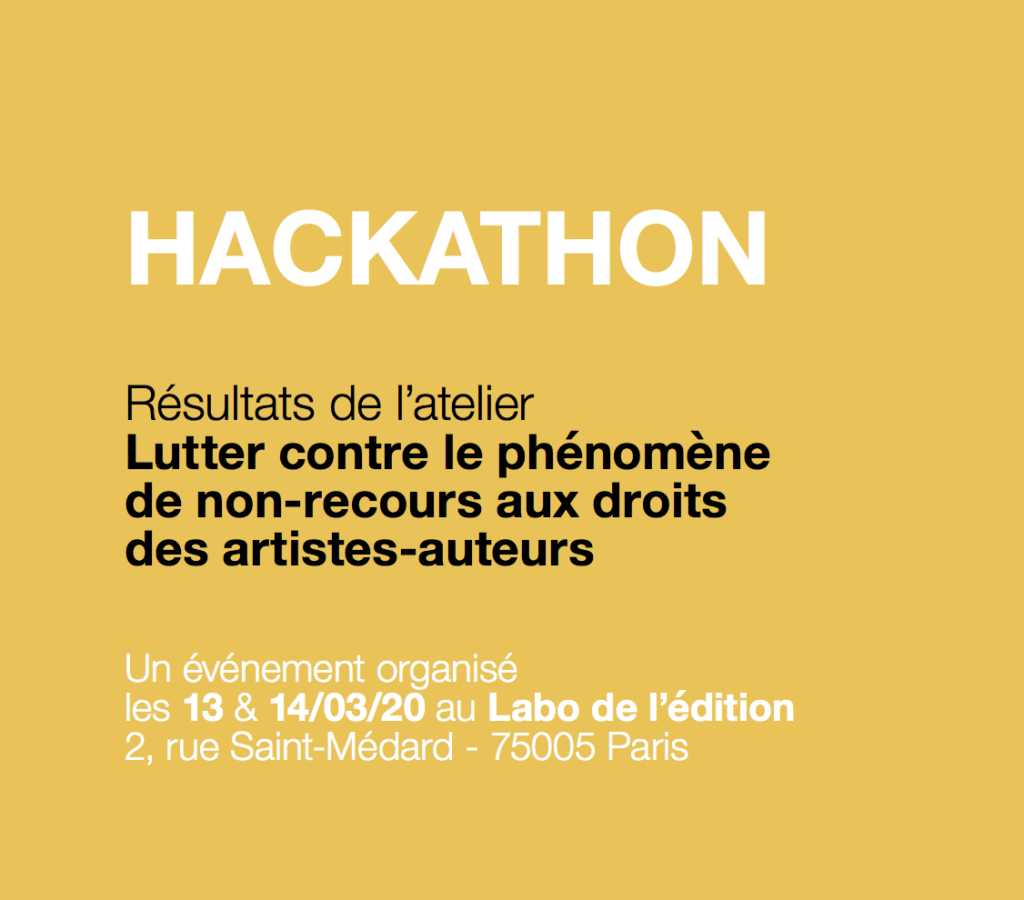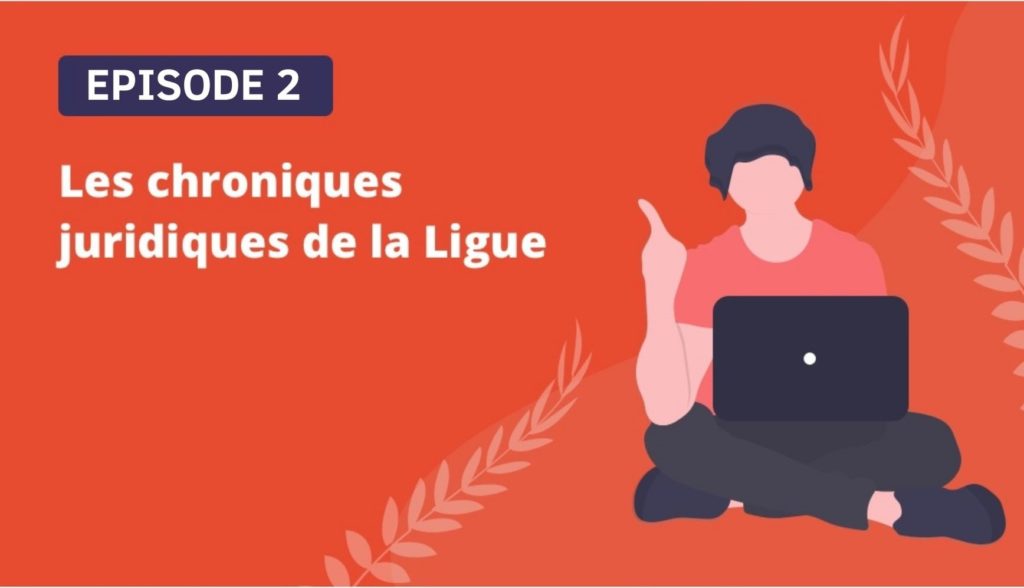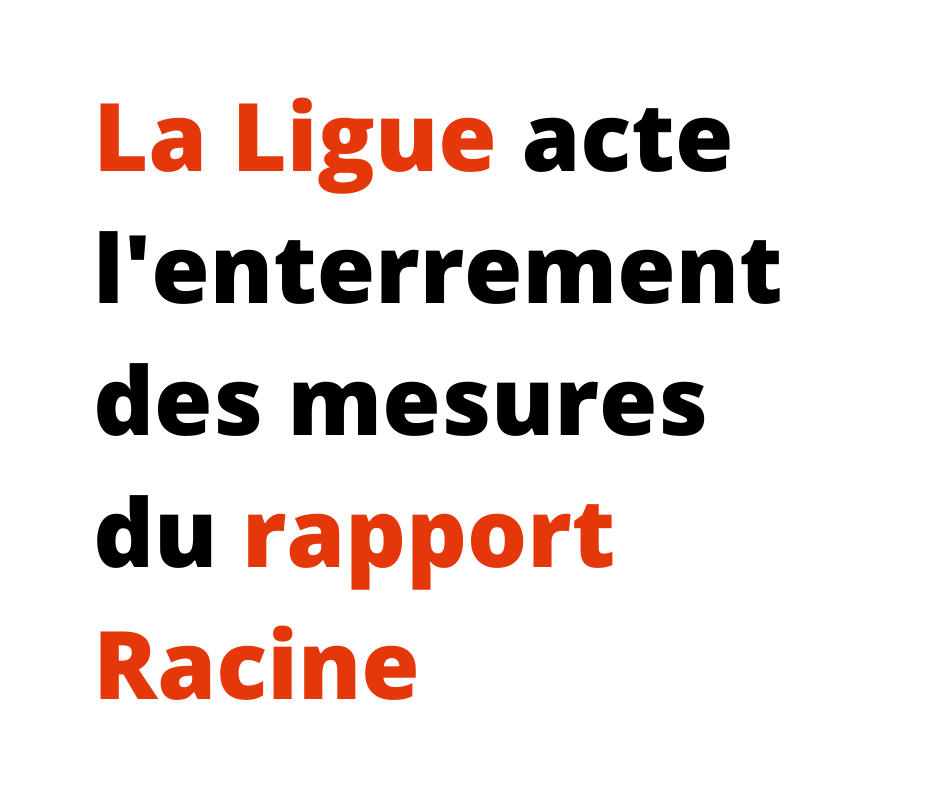
En réponse aux mouvements sociaux des auteurs et autrices depuis 2014, le ministère de la Culture a décidé de lancer une grande mission prospective sur le statut des artistes-auteurs en 2019. L’objectif ? Sauver les métiers de la création en formulant une réponse politique forte et concrète à leurs difficultés, après un audit méticuleux.
La mission Racine aura demandé 10 mois de travail et sollicité aussi bien les équipes du ministère de la Culture que des experts extérieurs. Il en aura germé un rapport salué par un mouvement d’espoir inédit, mais surtout des mesures opérationnelles et peu coûteuses pour l’État afin de reconnaître le statut professionnel des artistes-auteurs, de renforcer leur défense collective et individuelle.
La Ligue acte aujourd’hui que les promesses formulées à de multiples reprises par le gouvernement ne sont pas tenues. Pire encore, malgré un diagnostic désormais irréfutable, le ministère de la Culture choisit délibérément d’ignorer les solutions très concrètes qui pourraient mettre fin à des décennies de souffrance sociale.
En matière de dialogue social, nous dénonçons les méthodes de communication et de travail utilisées par le ministère de la Culture. D’une part, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot-Narquin a présenté au plus haut du gouvernement un plan en faveur des auteurs aux “représentants des auteurs”. Les syndicats d’artistes-auteurs n’ont pas été conviés, dont la Ligue. Une autre réunion de présentation a ensuite été organisée en catastrophe le lendemain : le ministère de la Culture a omis de prévenir à l’avance une bonne partie des organisations syndicales. Aujourd’hui encore, le ministère de la Culture continue de confondre délibérément les organismes de gestion collective, les associations culturelles et les syndicats d’artistes-auteurs.
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU VENDREDI 12 MARS 2021
Pour résumer, face aux points de divergences que le ministère de la Culture a pu constater entre des organisations syndicales, des associations culturelles et des sociétés privées de gestion collective (divergences évidentes du fait que ces structures ne défendent pas les mêmes intérêts), le ministère a clairement botté en touche en refusant de jouer le rôle de modérateur et de médiateur qui lui incombe pourtant.
Nous vous proposons un décryptage détaillé des mesures du “plan auteurs”. Quatre mesures doivent être mises en œuvre au premier semestre 2021.
• Poursuivre le soutien économique d’urgence lié à la crise de la Covid-19.
Les artistes-auteurs continueront d’être éligibles au fonds de solidarité de l’Etat. C’est la meilleure nouvelle de ces annonces, qui n’est pas non plus une surprise – l’inverse aurait été dramatique. Rappelons que l’accès à ce fonds de solidarité national est le fruit d’un combat acharné des syndicats, le ministère de la Culture ayant au départ acté uniquement la mise en place de fonds sectoriels eux-mêmes délégués à des opérateurs privés multiples.
Les fonds sectoriels d’urgence seront abondés de 22 millions d’euros supplémentaires, mais nous ignorons à ce jour si les centres nationaux joueront pleinement leur rôle à l’égard des artistes-auteurs et autrices, et si les critères d’accès seront enfin harmonisés et non discriminants, car pour rappel, le fonds sectoriel pour les auteurs et autrices de livre, délégué au CNL, qui l’a lui-même délégué à la SGDL, n’a permis de soutenir que 700 auteurs et autrices. Nous avons plusieurs fois formulé la demande de fonds sectoriels réellement complémentaires du fonds de solidarité national, gérés par l’État et comportant des critères adaptés à la réalité de nos métiers.
Nous déplorons donc la méthodologie employée, car voilà près d’un an que beaucoup peinent à y accéder faute d’identification nette des artistes-auteurs et autrices. Les formulaires sont accessibles, mais souvent très tardivement et les intéressés ne parviennent pas toujours à réaliser techniquement leurs demandes. Formons le vœu que pour les prochains mois, tout soit mis en œuvre pour que ce fonds soit effectif.
• Assurer un meilleur suivi des auteurs au sein du Ministère
Le ministère propose le déploiement de la “Délégation aux politiques professionnelles et sociales des auteurs et aux politiques de l’emploi” au sein de la Direction Générale de la Création Artistique, ainsi que la mise en place d’un observatoire statistique annuel au sein du Département des Études de la Prospective et des Statistiques du ministère de la Culture.
Si la nouvelle peut être favorablement accueillie, elle avait déjà été annoncée précédemment, et n’est donc en rien une nouveauté à venir. On peut néanmoins sérieusement s’interroger sur les outils et informations dont dispose le ministère pour effectuer un véritable suivi statistique de nos métiers.
Les dernières réunions ont montré que le ministère persistait dans la volonté de penser les artistes-auteurs selon les circuits de diffusion de leurs œuvres, et non pas selon leurs métiers. De plus, pour saisir nos professions, encore faudrait-il avoir des remontées d’informations : la déclaration annuelle de l’Urssaf artistes-auteurs est l’un des rares outils permettant d’obtenir des informations sur la population des artistes-auteurs. Pourtant, malgré nos demandes répétées, l’Urssaf n’a pas saisi cette occasion de collecter les données indispensables à un véritable suivi.
• Assurer un meilleur accès aux droits sociaux existants
Le ministère veut réfléchir à des pistes d’améliorations pour résoudre les difficultés de mise en œuvre de la réforme dans le réseau des URSSAF. En ce qui concerne les indemnités journalières maladie et maternité, la réglementation sera adaptée afin que le seuil d’ouverture des droits soit temporairement abaissé, pendant la durée de la crise, pour permettre aux auteurs de pouvoir bénéficier de ces indemnités journalières en cas d’arrêts “maladie” ou de congés “parentalité”
Là encore, l’éclat de la mesure n’est qu’illusoire. Élargir l’accès à la protection sociale en abaissant le seuil d’ouverture pourrait être vu comme une mesure favorable si la garantie de ces droits sociaux était réellement effective. Or, en pratique les artistes-auteurs et autrices sont confrontés à des difficultés techniques absolument décourageantes pour accéder aux indemnités journalières qui leur sont pourtant dues au nom de la sécurité sociale.
Les non-recours aux droits sociaux sont parfaitement identifiés de longue date, et sous les feux des projecteurs depuis plus d’un an. Aucune mesure concrète n’a été dévoilée par les ministères pour traiter efficacement le problème. Alors que les artistes-auteurs ont plus que jamais besoin de prestations sociales, ils font face à des refus récurrents alors qu’ils ont légalement droit aux prestations. Nous aurions espéré qu’au moins, sur ce point si évident, le ministère aurait depuis tout ce temps mis en place des solutions opérationnelles. Ce n’est pas le cas.
• Mieux prendre en compte la diversité des revenus principaux et accessoires des auteurs à travers la mise en œuvre du décret du 28 août 2020 relatif à la nature des activités et des revenus des artistes-auteurs.
Cette mesure n’a rien de nouveau : le décret du 28 août 2020 est désormais acté. Sans aucune concertation, l’Agessa a même sorti des fiches pratiques de ce qui entrait ou non en vigueur en 2021 – sans que les organisations professionnelles soient consultées.
Le ministère a par ailleurs annoncé d’autres mesures qui doivent être mises en œuvre avant la fin de mandat. Nous commentons ici les mesures principales pour que les artistes-auteurs puissent bien prendre conscience des enjeux pour leurs professions.
• Recomposer le Conseil d’Administration de l’organisme de gestion de sécurité sociale des artistes-auteurs, à travers la désignation de ses membres par une enquête de représentativité
Depuis 2014, les artistes-auteurs se sont vus privés de la gouvernance de leur régime de sécurité sociale. La transition entre l’Agessa/MdA/Urssaf s’est faite de façon unilatérale, sans aucune concertation avec ces derniers. La ministre fait le choix d’écarter des débats la question des élections professionnelles en privant ainsi les auteurs et autrices de l’exercice de leurs droits civils et politiques.
Nous rappelons que les organismes de gestion collective sont mandatés par leurs adhérents pour récolter et distribuer les droits issus de la gestion collective, mais qu’ils n’ont absolument aucun pouvoir lorsqu’il s’agit de défendre les conditions de travail ou la protection sociale. Du reste, ils n’ont pas à être pour ou contre des élections professionnelles : cela ne les concerne pas.
Les représentants des artistes-auteurs ne peuvent pas être des sociétés privées ou alors, ce serait admettre que la France ne respecte pas ses obligations positives en matière de démocratie sociale… En l’état, elle s’expose à de graves manquements en privant les artistes-auteurs et artistes-autrices de leurs droits civils et politiques.
Nous avons questionné le ministère afin de savoir comment il comptait très concrètement mener à bien cette enquête de représentativité et sur la base de quels critères de représentativité. Il a indiqué que le Conseil d’État serait prochainement saisi pour mettre en œuvre une méthodologie. Une chose est certaine : les artistes-auteurs eux-mêmes n’auront pas voix au chapitre à travers des élections professionnelles, pourtant l’une des mesures phare du rapport Racine.
• Expertiser les modalités de mise en place d’un portail numérique accessible aux auteurs rappelant les règles juridiques, sociales et fiscales qui leur sont applicables
Cette promesse d’un portail artistes-auteurs est formulée depuis un an : on ne nous l’annonce donc pas opérationnel, mais on nous renvoie encore un calendrier ultérieur. Or aujourd’hui, ce sont des syndicats tenus à bout de bras par des artistes-auteurs et autrices bénévoles qui font le travail d’information qui incombe à l’État ! Sans parler des injonctions contradictoires et autres flous qui perdurent faute d’une harmonisation du statut.
• Clarifier et simplifier pour l’avenir les règles fiscales applicables aux différents types de revenus perçus par les auteurs
Enfin, après des décennies de flou, l’État a mis à jour sur le site servicepublic une fiche très claire sur la fiscalité en vigueur pour les artistes-auteurs. Ces derniers en ont pris acte et ont commencé à modifier leurs pratiques en fonction. La mise en place de facturations pour nombre de prestations entrant dans le régime artistes-auteurs est un soulagement pour beaucoup ainsi qu’une professionnalisation permettant de nous identifier. Que signifie clarifier et simplifier, alors qu’une mission fiscalité a livré en concertations des conclusions limpides sur nos démarches, levant les ambiguïtés passées et faisant cesser les bricolages ? Les règles du jeu vont-elles encore changer ?
• Accompagner les négociations professionnelles sui generis sur l’équilibre de la relation contractuelle, notamment dans les secteurs du livre, de l’audiovisuel et du cinéma
La question de la représentativité se pose à nouveau puisque le recours à la négociation collective impose nécessairement de définir au préalable les partenaires sociaux chargés de négocier. Autrement dit, la négociation collective impose de mettre en œuvre un cadre légal de la représentation collective.
Or, le ministère botte en touche quant à la question de savoir comment il assurera la légitimité à de tels accords collectifs, sans déterminer de manière légale qui sera à la table des négociations.
D’une manière surprenante et même inquiétante, ses représentants ont assuré que les accords professionnels étant des accords sui generis, ils n’auraient pas à respecter les principes généraux et obligations positives de la France en matière de représentation syndicale, ce qui du point de vue juridique est, en plus d’être inquiétant, très contestable.
• Expérimenter l’instauration d’une rémunération des auteurs de bande dessinée pour les actes de création réalisés dans le cadre de leur participation à des salons et festivals
L’idée de cette expérimentation était déjà discutée et actée il y a plus d’un an avec le précédent cabinet du ministère, sans que cette mesure soit entrée en application concrètement. Alors que le rapport Racine préconisait une rémunération à la présence en festivals pour les auteurs et autrices de BD et jeunesse, ce qui laissait déjà hélas sur le côté d’autres artistes-auteurs, seuls les dessinateurs et dessinatrices de BD seraient concernés par cette mesure. Concrètement, si le festival d’Angoulême était pris comme terrain d’expérimentation, cela représenterait environ 40 personnes rémunérées… en imaginant que le festival puisse avoir lieu vu les circonstances.
Cette mesure n’est en rien un parti fort dans la reconnaissance du travail effectué par l’ensemble des artistes-auteurs et autrices, peu importent leurs métiers, quand ces derniers vont à la rencontre du public. On voit ici tout le préjudice d’une appréhension politique des créateurs et créatrices par secteurs : il est impératif de penser l’exemplarité de l’État en matière de rémunération pour l’ensemble des professions, et ce de façon contraignante et non expérimentale.
Enfin, le ministère annonce qu’il fera aboutir les travaux en cours concernant la rémunération du droit d’exposition des artistes par les musées et les FRAC et améliorera la structuration, la mise en réseau et la visibilité de l’offre de résidences d’écriture sur l’ensemble du territoire.
Le ministère préconise enfin d’ouvrir trois missions de réflexion. Une première sur les métadonnées des images fixes, une deuxième sur le financement de la production et de la diffusion d’œuvres photographiques et une troisième sur l’opportunité et les modalités de création d’un médiateur des arts visuels. Si les sujets traités sont évidemment capitaux et méritent en effet d’être soumis l’expertise de spécialistes, c’est la méthode qui interroge encore. Rédiger des rapports est une chose, les mettre en œuvre en est semble-t-il une autre pour ce ministère. Pour preuve, ce plan n’est qu’un détricotage des mesures du rapport Racine.